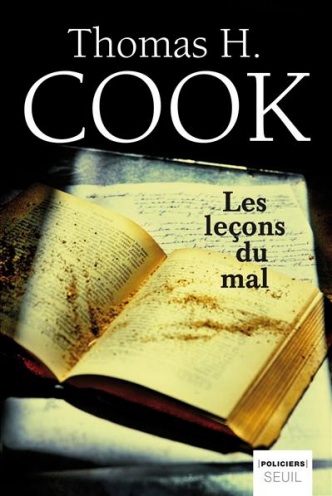On dirait vraiment le paradis, publié aux États-Unis en 1982, peu avant la mort de son auteur, a été traduit en français plus de vingt ans après. Si le roman semble ne rien avoir perdu de son actualité et de sa pertinence, il ne m’a pas convaincu tant pour l’histoire (ou plutôt les histoires) que pour l’écriture…
 Lemuel Sears est un homme vieillissant qui refuse obstinément d’admettre le passage du temps. Il multiplie les aventures amoureuses, si possible avec des femmes impossibles pour que le défi soit plus grand, et se lance dans de nouvelles expériences – gardons le suspense ici, mais la dernière du récit m’a paru moins que crédible. À côté de ses péripéties relationnelles, on suit Sears dans sa récente croisade écologique.
Lemuel Sears est un homme vieillissant qui refuse obstinément d’admettre le passage du temps. Il multiplie les aventures amoureuses, si possible avec des femmes impossibles pour que le défi soit plus grand, et se lance dans de nouvelles expériences – gardons le suspense ici, mais la dernière du récit m’a paru moins que crédible. À côté de ses péripéties relationnelles, on suit Sears dans sa récente croisade écologique.New Yorkais, il est néanmoins très attaché à la nature et notamment à la petite ville de Janice où habite sa fille. Un jour d’hiver qu’il se rend pour y patiner au grand étang non loin de chez elle, il découvre que l’espace est utilisé comme décharge publique, et avec l’aval des autorités ! Il engage alors un cabinet d’avocats pour enquêter sur cette autorisation douteuse et faire les démarches nécessaires à sa mise en cause.
Défilent alors, comme autant de personnages d’histoires parallèles, politiciens véreux, mafieux et citoyens lambda se déchirant pour des prétendues nuisances sonores…
Cheever accole ces courts récits sans les faire se croiser réellement : ils sont certes liés par leur proximité à l’étang, mais le tout manque malheureusement de cohérence.
Au final, tout se mêle dans un texte trop court pour cela : les difficultés de l’âge, les relations sentimentales, la pollution organisée, la mafia, les conflits de voisinage, la corruption…
On dirait vraiment le paradis m’a fait l’impression d’une longue nouvelle qui effleure voire mentionne beaucoup de choses mais n’en traite véritablement aucune. Certains lisent dans cette multiplicité une passionnante évocation des tourments de l’époque. À vous de voir…
Quant au style, l’usage intempestif de l’imparfait donne selon moi quelque chose de très artificiel au texte.
En définitive, ce n’était pas une lecture désagréable mais On dirait vraiment le paradis ne m’a pas laissé un grand souvenir…
On dirait vraiment le paradis, John Cheever (Joëlle Losfeld, 128 pages, 2009 / Folio, 144 pages, 2010) (1982) Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laetitia Devaux