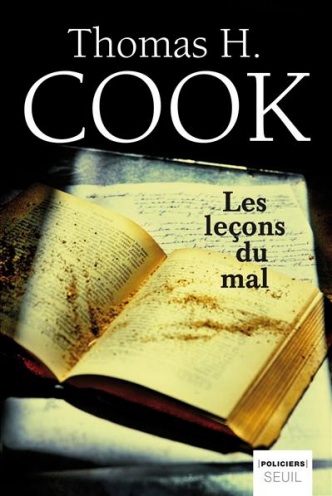Suite de mon rattrapage de la rentrée littéraire 2011 avec Famille modèle, un premier roman détonant : puissant, étrange, désespéré… Mais avec un petit quelque chose en trop qui m’a laissée songeuse.
 Warren Ziller – on l’apprend dès les premières lignes – est complètement ruiné et tente dans un espoir vain, bien entendu, de le cacher : la grosse Chrysler aurait été volée dans le garage même de leur banlieue cossue, l’enlèvement des anciens meubles aurait malencontreusement précédé la livraison des nouveaux, etc. Agent immobilier, Warren a suivi les conseils d’un ami et fait déménager son épouse Camille et leurs trois enfants de leur tranquille Wisconsin vers l’Eldorado californien ; et ce, pour investir dans un projet de condominium en plein désert. Projet qui s'est avéré catastrophique et a englouti toutes leurs économies – même celles pour l’université de leur aîné, qu'il est censé commencer dans quelques mois.
Warren Ziller – on l’apprend dès les premières lignes – est complètement ruiné et tente dans un espoir vain, bien entendu, de le cacher : la grosse Chrysler aurait été volée dans le garage même de leur banlieue cossue, l’enlèvement des anciens meubles aurait malencontreusement précédé la livraison des nouveaux, etc. Agent immobilier, Warren a suivi les conseils d’un ami et fait déménager son épouse Camille et leurs trois enfants de leur tranquille Wisconsin vers l’Eldorado californien ; et ce, pour investir dans un projet de condominium en plein désert. Projet qui s'est avéré catastrophique et a englouti toutes leurs économies – même celles pour l’université de leur aîné, qu'il est censé commencer dans quelques mois.Plus que ses manœuvres risibles pour cacher les faits, ce sont les portraits des trois enfants, de Camille, les écarts entre chacun creusés par les années, les méandres de l’adolescence, les particularités du benjamin, qui rendent le texte particulièrement savoureux et explosif. Parce que, c’est vite évident, le titre du roman a tout de l’antiphrase : la famille Warren est bien loin d’une Famille modèle.
Le lecteur se demande avec délectation (ou angoisse, c’est selon) comment le fragile secret va finir par être éventé, car c’est inévitable. Et, bien sûr, après maintes péripéties des uns et des autres, cela fini par se produire.
Pour autant, la famille Ziller est loin d’être au bout de ses peines – nous sommes tout juste à la moitié du roman – et un terrible accident va faire basculer le récit dans un désespoir bien plus rude. Certes, toujours sur le ton de la tragicomédie, mais le goût est devenu amer.
Avec un cynisme virtuose, Eric Puchner dégomme point par point le rêve américain dans la première partie, pour ensuite approfondir certains aspects et faire évoluer ses personnages dans une tout autre direction. Mais, à la longue, j'ai fini par trouver l’ensemble trop pesant, les héros trop accablés, les mécanismes répétitifs. J’aurais eu envie d’un peu d’optimisme, de chance, de joie – un tout tout petit peu… Et pourtant, j’adore cet humour grinçant ! Là est mon hésitation.
Le texte n’en est pas moins brillant, vif, sans concession pour les personnages. Eric Puchner signe (après un recueil de nouvelles remarqué) avec Famille modèle un premier roman très maîtrisé, drôle, explosif et terrifiant à la fois.
Alors, si vous aimez les récits caustiques, que le rêve américain vous fait doucement rire, que vous ne cherchez pas une lecture réconfortante, Famille modèle est à découvrir. Mais gardez-vous de trop d'empathie, vous aurez été prévenu !
Famille modèle, Eric Puchner (Albin Michel, 544 pages, 2011)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par France Camus-Pichon